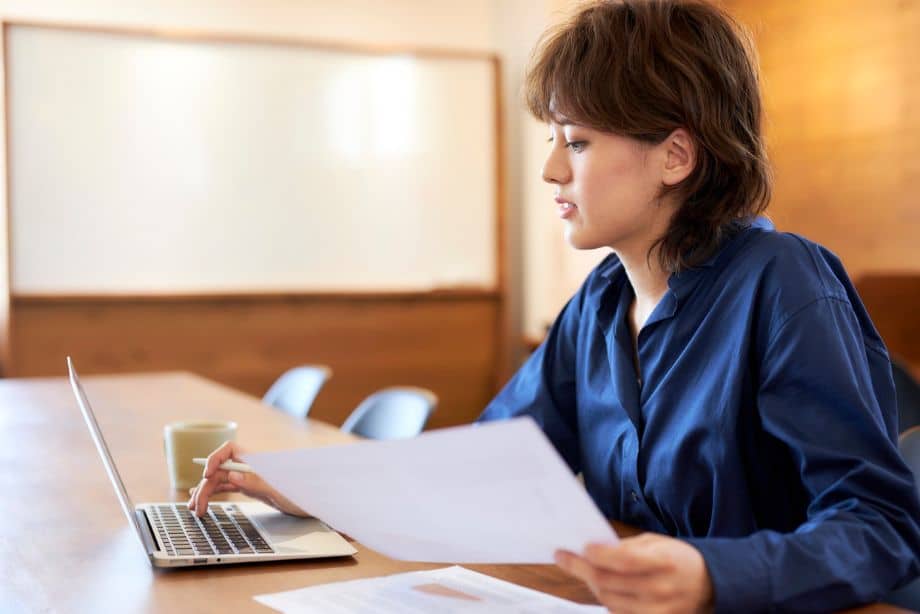Vous venez de perdre votre conjoint fonctionnaire, ou vous anticipez ce moment difficile avec toutes les questions qu’il soulève. L’aspect émotionnel est immense… mais très vite, les réalités administratives prennent le dessus. Parmi elles, la fameuse pension de réversion. Vous vous demandez si vous y avez droit, combien vous allez toucher, et surtout… jusqu’à quel point vos revenus peuvent jouer contre vous. Car oui, dans la fonction publique, il existe un plafond de ressources à ne pas dépasser. Et la moindre erreur ou omission peut vous faire perdre cette aide à vie. Le plus déroutant ? Beaucoup de veufs et veuves pensent y avoir droit de manière automatique. Erreur. Le dispositif est strict, les conditions très précises, et 2025 apporte quelques évolutions subtiles qu’il vaut mieux connaître maintenant… plutôt que trop tard.
À qui s’adresse la pension de réversion dans la fonction publique ?
Une prestation réservée aux ayants droit du défunt agent public
La pension de réversion concerne les conjoints ou ex-conjoints d’un fonctionnaire décédé, qu’il soit en activité ou à la retraite au moment du décès. Elle permet de toucher une partie de sa retraite, calculée sur le montant qu’il percevait (ou aurait perçu) s’il était vivant.
Mais attention : le concubinage et le pacs ne donnent aucun droit à cette pension. Il faut avoir été marié. En cas de divorce, vous pouvez toujours toucher une part proportionnelle à la durée du mariage… à condition de ne pas être remarié.
Les enfants ? Non concernés par la réversion
Contrairement à d’autres régimes (comme les retraites complémentaires), les enfants ne peuvent pas percevoir de pension de réversion dans la fonction publique. Le dispositif est strictement réservé au conjoint survivant.
Le montant versé et son mode de calcul
Une part fixe : 50 % de la pension du défunt
Le montant brut de la pension de réversion représente 50 % de la retraite que touchait ou aurait touché le fonctionnaire. Ce taux ne varie pas selon les ressources, l’âge ou la durée du mariage.
Mais ce n’est qu’un début. Car ensuite vient le plafond de ressources à ne pas franchir. Et là, tout peut basculer.
Les régimes concernés
Il faut distinguer les trois grandes fonctions publiques :
-
fonction publique d’État (enseignants, policiers, etc.)
-
hospitalière (infirmiers, aides-soignants…)
-
territoriale (employés communaux, agents de collectivité)
Tous suivent globalement le même cadre, même si certains détails d’application peuvent varier légèrement, notamment dans le traitement administratif.
Le plafond de ressources en 2025 : la limite à connaître
Le seuil officiel à ne pas dépasser
En 2025, pour bénéficier d’une pension de réversion en tant que conjoint survivant dans la fonction publique, vos ressources personnelles ne doivent pas excéder 24 232 € par an, soit 2 019 € par mois environ.
Ce plafond concerne l’ensemble de vos revenus : salaires, pensions, rentes, revenus du patrimoine… tout est pris en compte. Et c’est la somme de vos ressources sur les trois derniers mois qui est utilisée pour calculer l’éligibilité.
Un dépassement, même minime ou ponctuel, peut suspendre le versement ou empêcher l’ouverture du droit.
Les revenus exclus ou partiellement pris en compte
Bonne nouvelle : certains revenus ne sont pas intégralement comptabilisés. Par exemple, une pension alimentaire reçue pour un enfant à charge n’est pas ajoutée à vos ressources. Même chose pour certaines aides sociales non imposables (comme l’AAH, l’APL ou la prime d’activité).
Mais méfiez-vous des revenus de placements (assurance-vie, épargne…). Ils sont bien souvent inclus dans le calcul, même s’ils ne sont pas perçus sous forme de rente.
Les pièges à éviter au moment de la demande
Ne pas déclarer un revenu ponctuel peut vous coûter cher
Un oubli, un revenu exceptionnel non mentionné, ou une estimation trop vague… et vous risquez une suspension de la pension quelques mois plus tard. L’administration fiscale recoupe de plus en plus de données automatiquement, y compris les comptes bancaires.
Autant dire que toute erreur peut se transformer en trop-perçu à rembourser, souvent avec des intérêts.
Le cas des ex-conjoints : ce que vous devez savoir
Si vous êtes divorcé(e) mais non remarié(e), vous avez potentiellement droit à une part de la pension de réversion. Mais uniquement si :
-
vous avez été marié(e) au fonctionnaire décédé
-
vous ne vous êtes pas remarié(e)
-
vous respectez le plafond de ressources
Cette part sera calculée au prorata de la durée de votre mariage par rapport à la durée totale d’assurance du défunt.
Exemple : vous avez été marié(e) 10 ans à votre ex-conjoint qui a cotisé pendant 30 ans. Vous avez donc droit à 1/3 des 50 % de pension.
Articles similaires
- Pension de réversion dans la fonction publique : un tout petit détail pourrait bien tout changer en 2025
- Mon mari est décédé juste avant la retraite : Est-ce que je vais toucher une pension de réversion ? Voici comment ça marche
- 54% de la retraite et moins plus de 1600 euros : les conditions cachées de la pension de réversion
- Attention, piège : ce détail méconnu de la pension de réversion pourrait vous faire perdre des centaines d’euros
- Quel est le montant de revenu à ne pas dépasser pour bénéficier de ma retraite et de la pension de réversion de mon conjoint ?

Benjamin Lambert est spécialisé dans l’analyse des marchés financiers et la gestion d’actifs. Avec plus de 12 ans d’expérience, il apporte des analyses claires sur les tendances boursières, les investissements durables et les stratégies fiscales. Sur FAIRE, Pierre décrypte l’actualité économique pour mieux vous guider dans vos choix financiers.